Covid-19 et VIH
Depuis l’émergence de la pandémie COVID-19 à ce jour, aucune preuve (scientifique et clinique) n’a été trouvée qui puisse indiquer qu’une personne séropositive serait plus vulnérable à l’acquisition du coronavirus qu’une personne séronégative.
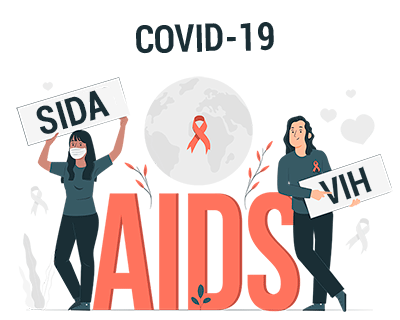
L’enjeu pour la PvVIH
une réponse immunologique adéquate, obtenue par une bonne adhérence à un traitement antirétroviral efficace, bénéfices mesurés par des tests de suivi, en particulier le taux de CD4 et la charge virale.
Pour cette raison, il est essentiel que les personnes aient accès aux tests de diagnostic du VIH et que les personnes séropositives puissent recevoir un traitement immédiat et dans la durée.
Une personne séropositive en traitement parvient en six mois à réduire sa charge virale dans le sang à un niveau indétectable. Cette situation signifie que la PvVIH ne transmet plus le VIH (indétectable équivaut à non transmissible).
Des données préliminaires dans les pays à épidémie généralisée et dans des contextes de faible accès au traitement anti-VIH, montreraient la survenue de complications chez les personnes vivant avec le VIH lors de l’infection à la COVID-19.
Dans ce contexte, la mortalité serait de 4% plus élevée, bien qu’il n’y ait aucune preuve que cette surmortalité puisse être attribuée au VIH.
Les recommandations de l’ONUSIDA
Les personnes vivant avec le VIH et celles exposées à un risque d’infection (VIH) doivent continuer à avoir accès aux services liés au VIH : préservatifs, traitement de substitution aux opiacés, aiguilles et seringues stériles, réduction des risques, prophylaxie pré-exposition, dépistage du VIH, etc.
Les pays doivent mettre en place la possibilité de délivrer des ordonnances (ARV) pour trois mois ou plus afin d’éviter que des PvVIH épuisent leur stock de médicaments, mais aussi en vue de réduire leurs besoins de recourir au système de santé.
Les personnes vulnérables doivent avoir accès aux services liés à la COVID-19, ce qui passe par une stratégie s’adressant spécifiquement aux populations marginalisées et visant à supprimer les barrières financières comme les redevances.
Effet indirect de la COVID-19 sur le VIH
Des prédictions alarmistes ?
Le groupe en charge des modélisations -convoqué par l’OMS et l’ONUSIDA- a estimé que si des efforts n’étaient pas déployés durant la pandémie de COVID-19 pour atténuer et surmonter les perturbations entrainées au sein des services de santé et dans l’approvisionnement en fournitures sanitaires, alors une interruption de six mois des traitements antirétroviraux pourrait entraîner plus de 500 000 décès supplémentaires liées au sida (tuberculose comprise), en Afrique subsaharienne, en 2020-2021.
Par ailleurs, un grand nombre de décès continuerait à être observés du fait de cette interruption, et ce pendant au moins les cinq années suivantes, avec un nombre annuel moyen de décès supplémentaires de 40 %.
Ce seraient les perturbations d’accès aux TARV –eux-mêmes liées à la COVID-19- qui auraient le plus d’impact sur la mortalité observée chez les PvVIH en Afrique du Sud.
Il y a donc un enjeu majeur à garantir le continuum des traitements et limiter, le cas échéant, la durée d’interruption TARV à 1 ou 2 mois au maximum
Décès par VIH évités
Les décès par VIH évités seraient 90 fois plus élevés que ceux qui seraient imputables au SARS-CoV-2.
Perturbations TARV dues à la COVID-19
36 pays ont signalés des perturbations dans la fourniture de service depuis avril 2020 (ensemble de pays qui concentre 45% des PvVIH ; soit 11,5M PvVIH) pour pallier ces délais –ruptures de stock l’OMS apporte son soutien.
Effet de l'hépatite C
La plupart des pays ont souffert du fait que l’hépatite C n’était plus une priorité de santé pour les décideurs; malgré cette difficulté, les gouvernements se sont appuyés sur les organisations communautaires pour continuer à travailler sur la prévention du VHC et ils se sont retrouvés dans une situation où ils ont dû prendre en compte les demandes de la société civile pour la décentralisation des services et la simplification afin de réduire le fardeau du système de santé. Coalition PLUS attend plus de réactivité à la demande de décentralisation et de simplification dans le futur car les enjeux soulevés par la pandémie ont confirmé la cohérence de ses demandes.
Vivre avec le VIH n'implique pas un risque accru vis à vis de la COVID-19
La riposte au VIH à l’heure
de la COVID-19
Les gouvernements sont tenus de respecter les droits humains et la dignité des personnes touchées par la COVID-19. Les enseignements tirés de l’épidémie du VIH peuvent s’appliquer aussi à la lutte contre le coronavirus.
Nous demandons aux gouvernements de travailler avec les communautés afin de trouver avec elles les solutions locales comme c’est le cas pour la riposte au sida. La pandémie de COVID-19 ne doit pas se traduire par une recrudescence de la stigmatisation et de la discrimination envers les populations clés.
Onusida a publié un guide et une infographie sur l’importance de préserver les droits de la personne humaine dans le contexte de la lutte contre le Covid-19.
Ce guide vise à rappeler quelques leçons de l’épidémie de VIH.
Selon l’institution : «Notre réponse à la COVID-19 doit s’appuyer sur les réalités de la vie des gens et être axée sur l’élimination des obstacles auxquels les individus sont confrontés pour pouvoir se protéger et protéger leurs communautés. L’autonomisation et les consignes, plutôt que les restrictions, peuvent permettre de s’assurer que les individus puissent agir sans peur de perdre leurs moyens de subsistance, disposent d’une quantité suffisante de nourriture et vivent dans le respect de leur communauté. Cela nous procurera finalement une réponse plus efficace, plus humaine et plus durable à l’épidémie.»
La pandémie de Covid-19 rappelle à toutes et à tous que le VIH nous a appris à travailler avec et pour les communautés affectées, à investir dans des systèmes de santé agiles et résilients, à être acteur à part entière des politiques de santé !
